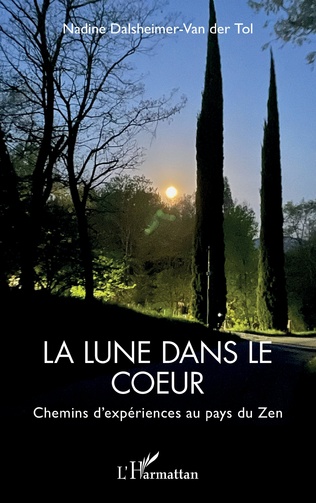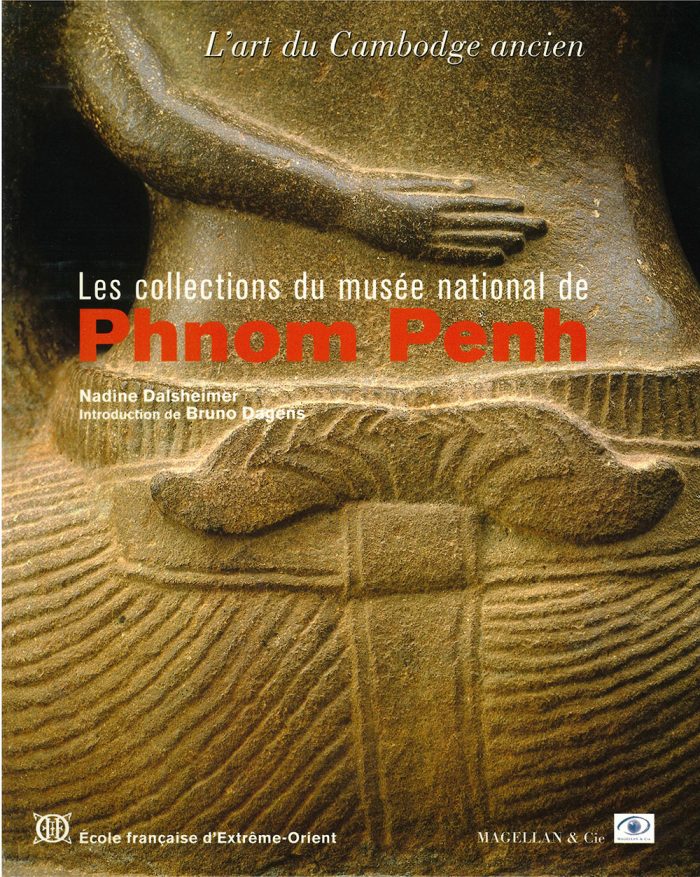Présentation de l’ouvrage intitulé « La lune dans le cœur »
Ed. L’Harmattan
Introduction
Le besoin impérieux d’écrire le récit de mon vécu intérieur sur la Voie de l’action proposée par Karlfried Graf Dürckheim s’est imposé. Je n’ai eu aucun autre choix si je voulais me maintenir en vie et heureuse. Écrire a donc été un acte de vie et une magnifique occasion de toujours garder en moi cette joie en suspens tel un sublime amour qui se maintiendrait intact et sans avoir besoin de s’assouvir.
Karlfried Graf Dürckheim, docteur en philosophie et psychologie, a passé de nombreuses années au Japon où il s’est intéressé au Zen en étudiant les arts et plus particulièrement celui du tir à l’arc avec un maître japonais de la technique. Sa spécificité est d’avoir adapté le Zen oriental à l’esprit de l’homme occidental. Il a écrit de nombreux livres sur cette approche et a ouvert un centre Zen en Allemagne, en forêt noire, où il a transmis son expérience, partagé sa connaissance et communiqué son enseignement notamment à mon maître, Jacques Castermane.
Dès le début j’ai été touchée par cet enseignement tant il faisait écho à mes expériences passées de vie, notamment en Asie du sud-est où j’ai passé de nombreuses années à étudier des statues empreintes de sagesse et de sérénité à laquelle j’avais d’ailleurs dédié une thèse de doctorat. C’est naturellement que, quelques années plus tard, j’ai commencé à pratiquer Zazen.
« Il y a 1001 façons de pratiquer, mais une seule manière de pratiquer Zazen ». Hirano Roshi.
L’enseignement proposé au centre Dürckheim est précisément la pratique de Zazen, assise méditative en silence, à l’immobilité absolue. Un enseignement basé sur l’attention au corps vivant. L’attention donnée à la respiration y est centrale sans oublier l’ensemble des sensations corporelles. J’ai découvert intensément le corps vivant après l’avoir étudié dans mes travaux universitaires et de recherche à partir d’une approche plus anatomique. Un point essentiel est l’importance donnée dans le Zen au centre du corps, le Hara. Ce n’est pas étonnant que Graf Dürckheim se soit intéressé très finement à cette notion en lui consacrant un livre majeur
1. Qu’est-ce que Zazen ? assis (Za), calme (zen)
Zazen est une des 4 attitudes dignes (assis, allongé, debout et en marchant).
Zazen n’a qu’un but : la transformation de la personne qui pratique cet exercice. Le mot transformation est ici synonyme de maturation. Ce qui peut étonner est l’immédiateté de ce changement qui se révèle dans une expérience intérieure, l’expérience de la vraie nature de l’être humain (ce que G. Dürckheim désigne comme étant notre nature essentielle).
2. Contexte/transformation
Ce récit retrace mes débuts de la pratique de Zazen et le contexte dans lequel j’ai entrepris cette plongée.
Lors de l’année 2017, année de deuil et début de problèmes cardiovasculaires., mon cardiologue me demande de méditer. Très vite, j’ai commencé à méditer régulièrement, avec assiduité, et même avec une certaine ferveur, comme nous le conseillait le maître Zen Hirano Roshi. J’ai été fortement impressionnée par ce maître japonais, rencontré au centre en juin 2019. Il nous avait dit « Ayez foi en Zazen ! ».
Ce récit est aussi en filigrane le récit d’une guérison.
Je suis au début du chemin, j’ai encore du mal à me débarrasser de cette anxiété sous-jacente qui me pousse à bruler ma vie, de mon impatience chronique. Le travail sur la respiration m’apporte énormément. Je dompte mon impatience qui me joue des tours à coup de grandes respirations. Commence alors pour moi une lutte, je déclare officiellement la guerre à mon moi despotique, car j’ai le désir profond de renouer avec ma vraie nature, de me relier à mon être essentiel, enfoui très loin, mais que j’ai eu l’émotion de rencontrer momentanément.
Voyage au centre de soi-même
Dès les premières années, je me suis sentie différente, plus légère, plus détendue et mon entourage le remarque. Mes enfants m’appellent alors « maman-bouddha ». Que peut-on offrir de mieux à des enfants que d’être un parent apaisé, je le réalise à présent et ne peux que regretter de ne pas l’avoir été plus tôt. Néanmoins, cet apaisement n’est pas un état permanent, et l’agitation reprend parfois encore le dessus brutalement. Je remarque, de façon stupéfiante, cette juxtaposition entre moments calmes, apaisés, où je retrouve ma joie spontanée d’enfant et d’autres moments, plus sombres, où je suis contrariée, tendue. Le contraste m’apparait nettement et le chemin vers le calme profond, stable et durable me semble hors de portée. Dans ces moments déstabilisants, je me replonge dans le silence du Dojo de Mirmande où résonnent en moi les paroles prononcées par le Maître « Si tu ne trouves pas le calme ici et maintenant, tu le trouveras où ? Tu le trouveras quand ? ». Apaisement immédiat garanti. L’enseignement est aussi de toujours tout reprendre à zéro.
Toute ma vie j’ai cru qu’il fallait accumuler des connaissances extérieures, aller plus haut, voyager plus loin. J’ai acquis des savoirs, à l’université ou dans mes fonctions de chercheur. Aujourd’hui je réalise que ce n’était pas la voie royale pour développer une sérénité profonde. Au contraire je ne faisais que m’en éloigner. Il m’a fallu du temps pour comprendre que l’essentiel était d’aller au plus loin de soi-même. La réalisation de la thèse de doctorat a été une formidable opportunité afin d’apprendre à aller au fond des choses, mais qu’en est-il du fond de soi-même ?
La direction à prendre, proposée au Centre Dürckheim, est le Zen dans ce que cette tradition recèle d’universellement humain. Un chemin qui suppose la fidélité à l’exercice, à l’exercice de Zazen, au rituel de la bougie (« La technique est le chemin, le chemin est la technique » nous répète notre maître), à celui de la marche lente en Kin-hin, un chemin non à suivre, mais que
chacun se doit de tracer. L’exercice nous transforme, nous l’intégrons et ce n’est plus nous qui faisons, cela se fait.
3. La relation maître/disciple
La relation maître-disciple joue un rôle essentiel. Trois maîtres sont présents dans cet ouvrage,
- Paul Béquart, le maître initiateur, Première reconnaissance fulgurante.
Je l’avais rencontré alors qu’il faisait un cours sur la psychanalyse à un auditoire d’infirmiers dont je faisais partie. À la première minute, j’ai su que j’allais faire un long chemin, avec et grâce à lui. Si les vies antérieures existent, alors je le connaissais depuis des vies entières. J’ai été subjuguée par cette rencontre, frappée d’un ravissement délicieux, abasourdie par une révélation qui me dépassait si bien que j’étais incapable d’écouter la moindre de ses paroles.
Une telle reconnaissance est-elle un signe de l’être essentiel ?
C’est comme-ci j’avais été touchée de plein fouet par une vérité intuitive au-delà des apparences. À partir de ce moment, j’étais autre, submergée peut-être par une première rencontre avec mon être essentiel.
Doté d’une grande spiritualité, il m’a ouvert à un monde nouveau.
Ce qui est remarquable est qu’il cite Le centre de l’être (échange entre Karlfried Graf Dürckheim et Jacques Castermane). Je réalise que tout à un sens et se recoupe, car Jacques Castermane deviendra, de nombreuses années plus tard, une personne essentielle à ma vie.
- Jayavarman VII, le maître inspirateur
Lors de mes études, je vis pour la première fois le visage du plus grand roi du Cambodge ancien appelé Jayavarman VII, seconde reconnaissante bouleversante. Après cet exposé je décidais de changer le cours de mes études et de me spécialiser dans l’art du Cambodge ancien (Vème-fin du XIIème siècle). Un visage de Bouddha aux traits empreints d’une sérénité allait me bouleverser définitivement. Ce visage légèrement penché en avant, aux yeux mi-clos et au large sourire étiré aux commissures me réconfortait tant il dégageait une paix et une joie profonde. Le sourire entendu de celui qui a compris la souffrance des hommes confrontés à la maladie, la vieillesse et la mort.
Je m’étonnais à chaque instant que ces représentations ne soient pas vivantes tant elles agissaient en moi. Le visage de Jayavarman VII me réchauffait le cœur et m’ouvrait la voie vers la possibilité d’un espace de bonheur tranquille. Le voir m’apaisait. Une statue n’est pas un objet comme un autre, car elle est chargée d’une énergie puissante. Une statue comme maître pourrait paraitre insolite, néanmoins pendant des années je me suis imprégnée de cette présence, de ce contact, de ce toucher du grès fin.
Un tel bien-être est-il possible ? J’étais fascinée par le sourire de cette sculpture dont je comprendrais plus tard le sens. Mon être profond se manifestait là encore en me signifiant, par une émotion intense, vers où continuer à cheminer.
- Jacques Castermane, le maître authentique
Lors de son dernier passage au centre Dürckheim, Hirano Roshi a insisté sur l’importance d’être accompagné par un Maître authentique. « Dans le bouddhisme, il y a dix-mille enseignements, mais le plus important est de rencontrer un Maître authentique ». Il cite Dôgen Zenji « Si vous avez le désir profond de rencontrer un Maître authentique, à coup sûr vous ferez cette rencontre. Il y a des choses que l’enseignement ne clarifie pas, malgré cela nous avons la chance d’être nés sous la forme humaine et de pouvoir rencontrer l’enseignement d’un Maître authentique grâce auquel vous ne tomberez pas dans des Voies erronées ».
Jacques Castermane a suivi durant plus de 20 ans (1967-1988) l’enseignement de Karlfried Graf Dürckheim. Depuis 1981, il anime une école de méditation Zen dans la Drôme. Sa présence imposante me faisait ressentir ce qu’un être humain pouvait devenir. Un être humain qui partageait avec ses disciples sa qualité d’être, son expression d’être un cœur immense. Je ne pouvais pas ne pas le voir, ne pas l’entendre, ne pas l’aimer. Dans ce lien vrai du maître et du disciple se joue une expérience d’un amour recommencé où l’on est intensément vivant. Je ne me sens jamais aussi vivante que lorsque je suis au centre Dürckheim.
La relation entre un maître, clairement ou non identifié, et son disciple pourrait s’apparenter à une véritable histoire d’amour. C’est ce que j’ai vécu avec mes trois maîtres. Chacun fait subtilement écho à l’autre. Ces trois maîtres ont la même fonction, ouvrir au quatrième maître : le maître intérieur (qui permet de devenir notre propre maître)
La présence du maître est singulière. C’est comme être accompagné par un beau clair de lune. La lune en est d’ailleurs la meilleure métaphore du maître à vos côtés. En voyant la lune, précisément la pleine lune, nous nous sentons immédiatement apaisés, confiants, remplis d’une joie inexpliquée et il en est ainsi lorsque nous sommes accompagnés d’un maître véritable qui nous élève et nous éveille à notre vraie nature.
Conclusion
L’écriture de ce livre me permet de donner une cohérence à ma vie. Ce livre est l’histoire de ma vie, de mes expériences, de mon travail d’infirmière à l’écoute du corps humain jusqu’à celui de chercheur en Asie à décrypter le labyrinthe anatomique des statues khmères afin d’en saisir l’expression de la sensibilité. Il est question de cet enseignement du Zen proposé au centre Dürckheim qui me façonne jour après jour. De la fidélité à l’exercice de Zazen dont la saveur de l’immobilité est inégalée. Ce livre s’adresse aux personnes en chemin. Au début de ma pratique j’avais cherché un tel témoignage et je n’en avais pas trouvé. Je réalise que j’ai écrit ce témoignage. Un éclairage de la pratique de Zazen destiné à celles et ceux qui souhaitent donner du sens à leur vie et aller à la rencontre de leur vraie nature.
Ce chemin me maintient sur le fil de ma vie, c’est un trajet vers des terres inconnues que personne ne peut faire à ma place. Personne ne peut m’épargner l’effort de ce chemin à tracer. Grande est parfois ma solitude, mais foi et enthousiasme seront toujours mes armes ! Ces expériences de vie ne pouvaient que me mener vers l’écriture dont la puissance libératrice m’a transportée vers un ailleurs avec la sensation immensément vivifiante d’avoir la lune dans le cœur.
Présentations des précédents livres de Nadine Dalsheimer-Van der Tol
Le musée national de Phnom Penh expose des œuvres majeures de l’art du Cambodge ancien (Vème-fin du XIIème siècle apr. J. C.). Sa visite s’impose comme celle des sites prestigieux d’Angkor.170 œuvres parmi les plus belles et les plus représentatives de la collection sont ici rendues accessibles par une analyse claire, un aperçu historique et une introduction à la statuaire khmère. Il y a un siècle, l’École française d’Extrême-Orient recevait mission du gouvernement français d’inventorier, d’étudier et de préserver le patrimoine artistique du Cambodge. Aujourd’hui, elle a poursuivi cette action dans le cadre d’opérations en partenariat avec les institutions cambodgiennes, quelquefois sous l’égide de l’Unesco. Nadine Dalsheimer-Van der Tol, spécialiste de la statuaire khmère, a participé pendant douze ans aux programmes de l’École dans ce domaine. Elle lui a consacré une thèse de doctorat sous la direction du professeur Bruno Dagens. Cet ouvrage est un hommage rendu au génie des artistes khmers.
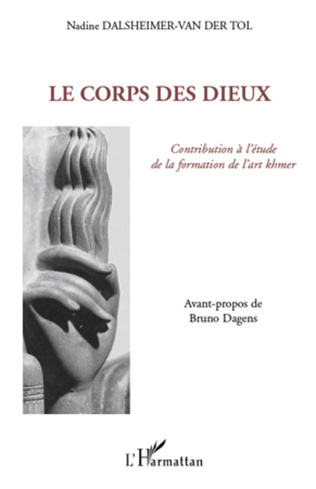 Cet ouvrage est une importante contribution à l’étude de la formation de l’art khmer (du Vème au VIIème siècle apr. J.-C.). Il présente une méthode d’analyse des statues du Cambodge ancien appliquée à un large éventail d’œuvres, en particulier aux sculptures des Dépôts de la Conservation d’Angkor. Il a été possible de regrouper les pièces et de les répertorier en familles de modelé selon les traits plastiques communs et les lieux de provenance afin d’identifier un système d’écoles localisées géographiquement. Ce regard neuf permet de mieux comprendre cette période, très riche, de la formation de l’art khmer et d’en préciser plus nettement les affinités plastiques négligées jusqu’alors avec les œuvres de pays voisins. Ces voyages de formes, mis en relief par des réseaux d’influences qui suivent des routes maritimes ou terrestres, offrent la possibilité de saisir l’art de l’Inde et d’Asie du sud-est dans son mouvement.
Cet ouvrage est une importante contribution à l’étude de la formation de l’art khmer (du Vème au VIIème siècle apr. J.-C.). Il présente une méthode d’analyse des statues du Cambodge ancien appliquée à un large éventail d’œuvres, en particulier aux sculptures des Dépôts de la Conservation d’Angkor. Il a été possible de regrouper les pièces et de les répertorier en familles de modelé selon les traits plastiques communs et les lieux de provenance afin d’identifier un système d’écoles localisées géographiquement. Ce regard neuf permet de mieux comprendre cette période, très riche, de la formation de l’art khmer et d’en préciser plus nettement les affinités plastiques négligées jusqu’alors avec les œuvres de pays voisins. Ces voyages de formes, mis en relief par des réseaux d’influences qui suivent des routes maritimes ou terrestres, offrent la possibilité de saisir l’art de l’Inde et d’Asie du sud-est dans son mouvement.